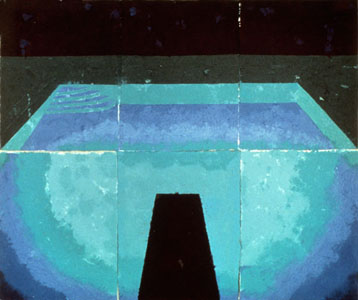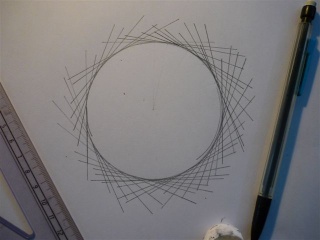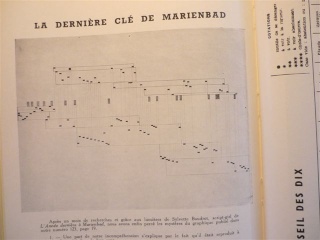Il ne faut pas se fier aux apparences :
Outrage est le film le plus directement et le plus radicalement politique de Kitano. Et son enjeu est tout autre qu'un simple retour aux premières amours.
Achille et la tortue ne mentait pas en annonçant, en conclusion de la trilogie fantaisiste ou fantasmatique, un renouveau stylistique complet (1). Sous les oripeaux fatigués du film de genre, Kitano reprend et subvertit tout un pan du cinéma japonais, celui de ses années de jeunesse et de formation autant que celui qu'il pratiquait lui-même, et inaugure une nouvelle période dans son œuvre.
Interrogé sur ce tournant dans la carrière de son ancien professeur de cinéma, le réalisateur Moriko Tetsuya (2) le confirmait et l'expliquait par l'abandon des préoccupations personnelles qui irriguaient ses ouvrages précédents. Et effectivement, le personnage romantique dont la violence dont la violence le dispute au désespoir, soit que l'une entraine l'autre ou l'inverse, ce personnage reste au vestiaire, remplacé par une ribambelle de caïmans cyniques et froids.
Achille et la Tortue annonçait déjà l'évolution en congédiant ce nihilisme flamboyant pour lequel Kitano s'est fait connaître en Occident (particulièrement avec
Sonatine) mais qui n'avait plus lieu d'être puisqu'il supportait des conflits désormais réglés et des inquiétudes dépassées. En somme, le « personnel » kitanien n'est plus ce qu'il était et
Outrage n'est de ce point de vue pas plus commercial ou moins investi que ses autres films. En témoigne l'intensité du contenu référentiel qui le traverse. Au début de
Glory to the filmmaker!, Kitano se servait des moniteurs d'imagerie médicale pour renommer son cerveau cinéaste avec les noms de Ozu Y, Fukasaku K, Kurosawa A et Imamura S. Et sauf pour Ozu, ces figures cinématographiques intimes se retrouvent dans
Outrage (3). Mais elles n'y opèrent pas comme des clins d'œil aux initiés, à la Tarantino, pas plus que Kitano ne joue avec les spectateurs à une espèce de
"Où est Charlie ?" spécial cinéma japonais. Elles donnent plutôt lieu à tout un jeu de renvois, un enchâssement des unes dans les autres (Kitano et les poupées russes) par lequel le film produit du sens.
Trivialité du criminel
Kitano n'a jamais caché sa dette cinématographique envers Fukasaku. En faisant ses débuts derrière la caméra avec
Violent cop, il remplaçait en fait le vieux Maître qui avait abandonné le projet par peur de devoir diriger le comique Beat Takeshi. Il finit quand même par l'enrôler pour
Battle Royale, tandis que Kitano lui rendait un hommage appuyé dans son Sonatine en reprenant des éléments de Guerre des gangs à Okinawa. Enfin Outrage, qui est la relation de l'ascension rapide et de la destruction brutale du clan Otomo pris dans les intrigues intestines du milieu yakuza, paraît inspiré de Combat sans code d'honneur, chronique de la constitution d'un clan dans le Hiroshima d'après-guerre, de sa montée en puissance et de sa décadence provoquée par l'avidité des uns et des autres et par les manipulations de son caïd et du Parrain local.
D'
Outrage à
Combat sans code d'honneur, des motifs se retrouvent avec des variations. Le corps tatoué de Misuno faisant l'amour pour la dernière fois évoque irrésistiblement celui de Hirono Shozo dans des circonstances presque semblables. Les phalanges coupées et offertes en réparation des offenses sont identiquement rendues par le Parrain dans les deux films, accompagnées d'un don d'argent qui sert surtout à appuyer la domination du donateur et à obliger le bénéficiaire à un règlement de comptes clan contre clan. Mais à la différence de ceux de Kitano, les personnages de Fukasaku sont aveuglés par le
jingi, notion rendue imparfaitement dans le titre français par « code d'honneur » mais qui renvoie plutôt à une suite de conduites ritualisées, dont l'obéissance au chef jusqu'à la mort et la mutilation propitiatoire sont les plus connues. Hirono pense qu'il fait l'amour pour la dernière fois parce qu'il a accepté la mission que lui a confiée son patron, dût-elle lui couter la vie, mais il s'agit aussi bien d'une illusion puisqu'il survit finalement à toutes les purges et les vendettas. Quant au don d'argent en échange de la phalange coupée, il n'oblige son bénéficiaire qu'en tant qu'il reste régi par le code rituel du
jingi, en l'occurrence le financement des funérailles du moignon. Combat sans code d'honneur montre ainsi l'importance idéologique du
jingi comme mode de pacification de la société dans le chaos de la défaite, puis son délitement face à une nouvelle réalité, où business et finances ont plus d'importance que les partages claniques. À la toute fin du film, Hirono Shozo, corps maigre flottant dans son costume, reste le dernier représentant du règlement traditionnel et se pose dans un rapport de répulsion à ce que sont devenus les yakuzas modernisés. Outrage se construit au contraire sur l'absence de cet homme contre son milieu au nom des traditions même de ce milieu. La phalange coupée est tout bonnement refusée comme pratique obsolète et démonétisée, tandis que le don d'espèces en est déconnecté et directement branché sur les tueries à venir. Et Misuno ignore qu'il fait l'amour pour la dernière fois car il n'a aucune idée de mourir pour son patron, ça ne fait pas partie de son programme qui parait plutôt être de s'enfuir le plus vite possible. Les personnages sont ainsi débarrassés de toute illusion, non seulement ils se savent pris dans un complexe d'intrigues et de manipulations multiples, mais ils s'en font les acteurs volontaires, ils y rajoutent tout ce qu'ils peuvent pour tirer leur épingle du jeu, s'emparer d'un nouveau territoire, devenir caïd à la place du caïd. Les frères jurés se spolient et s'entretuent, les comploteurs ne rêvent que de trahir leurs complices, le
jingi n'est qu'une vaste farce, un hochet pour gangsters mal dégrossis, et il ne reste personne, absolument personne, pour sauver la face de l'éthique yakuza en se dressant contre sa corruption, quitte à y laisser sa peau. Kitano s'oppose ainsi à la légende de la noblesse yakuza dans la façon dont elle a été remise à un héros solitaire aussi bien dans son propre cinéma que, à travers Fukasaku, dans tout le cinéma japonais.
Bureaucratie de la violenceMais le gangster chevaleresque n'est pas le seul à subir les outrages d'
Outrage. Kitano ne tombe pas dans l'espèce de posture post-moderne qui consiste à remplacer la glorification de l'homme violent et du pouvoir qu'il détient par une fascination pour la violence elle-même et pour son esthétique (4). On a beaucoup et très mal parlé de la violence dans
Outrage. Il est vrai que le film est plein de sang, de tortures inhabituelles (à la roulette de dentiste) et de mises à mort originales (pendu dans un accident de voiture, à la façon d'un strip des
Idées noires de Franquin). Mais tout cela est surtout montré sans complaisance : ni l'esthétique de la violence ni la douleur des victimes (toutes également maffieuses et tortionnaires) ne sont les sujets de ces scènes. La cruauté n'est qu'une question d'occasion associée à l'exécution d'un labeur normalisé. Les yakuzas sont dépeints en fonctionnaires du crime, ce qui n'est pas forcément une nouveauté ; mais surtout leur activité professionnelle est filmée en conséquence, non magnifiée et avec une absence d'emphase qu'on imaginerait bien appliquée à un travail de bureau. Kitano tient de façon paradoxale la promesse faite à la fin de
Takeshis', de ne plus faire de film de yakuzas. Car si Outrage met en scène des yakuzas et rien d'autre, c'est pour mieux étriller les canons du genre et il s'agit moins d'un « film de yakuzas » que d'un film sur des yakuzas. Ainsi, alors que Fukasaku procédait à la ré-inscription d'enquêtes mi-sociologiques, mi-policières, dans les cadres plus ou moins figés du genre, Kitano se livre à une recomposition quasi entomologique (meurtres commis par des insectes, sans passion et sans beauté) d'une société yakuza abstraite. Les séquences s'enchaînent sans intensification ni diminution au fil d'une intrigue qu'on a vite fait de perdre de vue. À la fin d'
Achille et la tortue, le peintre ne trouve plus, pour se représenter à sa sortie de l'hôpital, qu'à exposer une cannette rouillée et défoncée, objet industriel et de consommation de masse déchu de sa destination initiale et ré-investi dans une séquence nouvelle. Il s'agit moins d'une reprise – impossible – de l'urinoir duchampien que d'une inscription dans une esthétique du ready-made que Duchamp ne finit pas d'inspirer (l'exposition à la Fondation Cartier a révélé le talent de plagiaire du plasticien Kitano). Quoi qu'il en soit, cette cannette est présente à chaque plan d'
Outrage, comme principe d'une figuration dont la mise en scène serait au service d'une interminable enfilade d'objets-prêts. Le récit se délite sous la poussée de la répétition, la logique narrative (« à la suite de quoi... ») cède face à une logique accumulative (« une fois... une autre fois... »), soulignant la froideur, l'absurdité et l'irrémissible de chaque accès de brutalité.
On pense à la manière d'Imamura, à la précision distanciée avec laquelle il suit un tueur en série (
La vengeance est à moi) ou perd ses personnages dans les rues d'Hiroshima atomisée (
Pluie noire). Mais aussi, sous un autre aspect, à l'ethnographie imaginaire de La ballade de Narayama, où l'invention de toutes pièces d'une société et de sa culture permet son isolement et le développement en son sein d'une fable à portée universelle. Les yakuzas d'
Outrage sont dans la même situation que les villageois d'Imamura. À l'écran, tout est yakuza. Même le flic qu'on ne voit qu'en train de vendre ses services aux caïds ou au Parrain, surtout quand il a l'air de faire son travail de flic. Même l'ambassadeur qui ne tarde pas à se prendre à la dynamique criminelle et à réclamer une plus grosse part du gâteau. En somme, il n'y a rien, littéralement, en dehors des yakuzas, les yakuzas sont tout et tous, et cette abstraction de leurs pratiques en dehors de tout contexte social en fait un paradigme de l'ensemble de la société capitaliste. Leur violence bureaucratique n'est qu'une forme à peine exacerbée de la concurrence de marché et les variations qu'ils y mettent se résument à la production d'une plus-value sadique en marge de la plus-value économique. Puis, en installant un casino dans l'arrière-salle d'une ambassade africaine, et en enrôlant l'ambassadeur comme portier en frac avant de l'abandonner à faire le sale boulot avec une pelle et un cadavre (traiter les cadavres : le comble du déshonneur au Japon), les yakuzas ne font finalement pas autre chose que d'adopter la conduite des élites politico-industrielles vis-à-vis de l'Afrique. (Il n'y a pas à délirer un racisme de Kitano. Le personnage de l'ambassadeur n'est pas plus mal loti, cinématographiquement parlant, pas plus ridicule que la plupart des Japonais du film.) En fin de film, l'anéantissement des clans intermédiaires assure l'accès à l'hégémonie d'un Parrain à présent flanqué d'un comptable et lancé dans la haute finance. La Bourse, dernier Eldorado du crime organisé.
 Mort
MortKitano a souvent dénoncé la main mise des yakuzas sur le Japon (5). Outrage pousse à son terme la logique de ce constat. Ces nervis s'entretuant pour s'approprier les circuits économiques les plus rentables font la chronique de la montée d'un fascisme new look, un fascisme du tiroir-caisse dans lequel l'alliance de l'argent et du pouvoir s'est débarrassée des couvertures culturelles traditionnelles. Et comme tous les fascistes, ceux-ci n'ont qu'un mot d'ordre : vive la mort ! Ce n'est pas qu'ils se réjouissent d'être mortels, de pouvoir tuer et être tués. C'est que l'absence de leurs cas de conscience, le filmage singulièrement dépassionné de la violence et le refus délibéré de toute montée dramatique les placent entièrement du côté de la mort. La mort n'est pas leur métier, elle est leur essence. Pour Kitano, c'est l'occasion de régler un problème de représentation. Les plans de cadavre ne sont plus ce qu'ils étaient dans les films précédents, le temps nécessaire à la condensation du sentiment de la mort. À la place, ils figurent le résultat presque mathématique et sans importance de ce qui a fait venir là un cadavre. Car évidemment, dans ce monde de mort, la mort physique se pose en continuité naturelle et non en rupture de réalité. Mais en réglant ce problème, il en pose un plus général. Le titre du film reprend partiellement celui de
The Outrage, remake, réalisé par Martin Ritt, du
Rashômon de Kurosawa. Et effectivement, avec Outrage, Kitano organise sur une pluralité de films ce que
Rashômon faisait sur un film unique, c'est-à-dire la mise en relation de plusieurs témoignages, tous différents, à propos d'un même meurtre, jusqu'au récit d'un voyant parlant au nom de la victime, du côté de la mort (6). Et c'est là tout l'enjeu figuratif : embarquer tout un pan du cinéma japonais (et mondial, car le Japon n'a pas l'exclusivité des films glorifiant la violence) pour questionner les contenus admis de représentation de la violence et ce qu'ils signifient politiquement. On comprend mieux alors ce qui distingue
Outrage d'un film de yakuzas : si tous les canons du genre y sont repris avec méticulosité, c'est pour y être desséchés, vidés de leur substance et rendus à leur réalité morte. Le film ne se pose ainsi ni en rupture, ni en renouvellement. Il s'inscrit directement dans une continuité historique et grâce à cette inscription en constitue un point d'achèvement. D'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a plus de film de yakuzas possible après
Outrage. Et il faut avouer qu'il y a quelque chose de vivifiant à voir cette violence de domination ramenée à ce qu'elle est, éteinte dans son dévoilement : violence depuis la mort, dans la mort et pour la mort.
De Kitano, on peut désormais tout attendre, le pire comme le meilleur. Le pire, ce pourrait être par exemple une infinie reprise de tous ses films : après la révision de
Sonatine, celles de
Zatoïchi, de
Kids return, de
Jugatsu, de
Violent cop, etc., longue suite qui ne manquerait sûrement pas de s'enfermer progressivement dans la lassitude. Quant au meilleur
Stéphane Pichelin
(2) Interviewé pour Jet FM, à l'occasion du dernier Festival des 3 Continents, par Gérard Aubron et moi-même.
(3) Sauf défaut de vision de ma part, toute référence à Ozu est absente de Outrage. Ce n'est pas forcément étonnant. Dans son récent livre d'entretiens (Kitano par Kitano), Kitano est très explicite sur ce que le rythme propre à Ozu lui est parfaitement étranger. Quand au pastiche qu'il lui réservait dans
Glory to the filmmaker!, il était de loin le plus malaisé et inabouti du film.
(4) Quitte à excuser cette esthétisation de la violence par la déclaration d'une volonté politique de dénonciation, ce qui me semble être le cas chez des réalisateurs comme Miike, Ishii, ou Fukasaku sur la fin, quoi qu'il en soit par ailleurs de leurs talents respectifs.
(5) Par exemple dans le film que lui a consacré Jean-Pierre Limosin pour la collection Cinéma de notre temps (
Kitano, l'imprévisible). On a du mal, vu d'ici, à s'imaginer l'emprise sur le Japon de yakuzas qui ont tout à fait le pouvoir d'interdire un écrivain de publication ou un cinéaste de production. Là encore, Fukasaku en donne un témoignage effrayant dans Combat sans code d'honneur ou dans
Police contre syndicat du crime. Mais il y adjoint toujours un personnage romantique qui sauve in extremis la prétendue noblesse d'âme yakuza et inverse toute la dénonciation : tous pourris, sauf quelques gangsters. L'audace de Kitano radicalisant le propos en ne laissant aucune porte de sortie au système tient peut-être à une conjonction de facteurs, tels que sa relative indépendance de producteur (à travers Office Kitano), sa puissance de star médiatique (Beat Takeshi), ou le fait que ses films sont très marginalement distribués au Japon et font la plus grande part de leur carrière à l'étranger (notamment en France).
(6) On peut également noter à l'appui de cette idée que
Rashômon signifie Porte des démons et que la séquence pré-générique d'Outrage est constituée par un défilé de voitures de yakuzas, esprits mauvais, passant la porte de la propriété du Parrain.